Haïti : À la rencontre des filles vendues
Aux Verrettes, commune d’Haïti, une vielle « coutume » baptisée « Alantran » autorise des hommes à verser à des parents des sommes variées entre dix mille et vingt mille gourdes (soit 92 à 185 euros) pour avoir une jeune fille de 17 à 21 ans voire une fillette de 14 à 16 ans à titre de concubine ou épouse. Cette pratique créée des remous au sein des institutions qui œuvrent pour la protection de l’enfance en Haïti.
Une course en voiture, une autre à motocyclette et une dernière à cheval… le trajet qui sépare Port-au-Prince (capitale d’Haïti) à « Démarré », localité située dans la commune de Verrettes, département de l’Artibonite. Pour se hisser vers le sommet, il faut escalader des montagnes rocailleuses. Ce coin d’à peu près 2 mille 642 habitants, porte la naissance de l’un des plus grands présidents d’Haïti au 20e siècle : Dumarsais Estimé (16 août 1946 – 10 mai 1950). Ce n’est pas tant cette mémoire fascinante qui créé l’attraction, mais plutôt une forme de transaction économico-sexuelle ponctuelle qui s’impose à l’attention. Cet échange, préalablement négocié par les habitants de la zone, porte le nom d’« Alantran ».
N’étant pas homogène, elle est définie par certains pratiquants comme étant une coutume à part entière, qui facilite la reproduction sociale dans une union basée sur le concubinage. Le processus veut que les parents de la jeune femme reçoivent une compensation sous forme de dot. D’autres la voient comme étant une modalité coutumière, autorisant l’union des jeunes filles, mineure ou non, avec des hommes adultes d’une manière préalablement négociée, avec ou sans leurs consentements, moyennant qu’une compensation pécuniaire provenant des hommes soit versée aux parents de la jeune fille.
Selon les témoignages recueillis, certains parents échangent leur fille ou fillette à des hommes à des taux d’intérêt variables. À la base de cette transaction, deux motifs : d’abord l’idée de perpétuer une tradition régionale ; ensuite, l’ambition de tirer bénéfice sur la sexualité de leur enfant pour pouvoir faire face à des difficultés économiques cuisantes. C’est pratiquement la vente aux enchères d’impubères dépourvues de toute maturité sexuelle et de toute faculté de consentement.
Témoignages poignants des victimes
Dans des maisonnettes faites de boue, de chaux vive, et de bois, des (filles-mères) tentent d’inventer une vie dans un environnement montagneux où l’altitude chasse le qualificatif « tropical » d’Haïti avec des brouillards.
Resimène Jacques, fille-mère qui venait d’avoir l’âge adulte en avril 2019, allaite son garçon de 19 mois qu’elle a mis au monde à l’âge de 17 ans. Originaire de la localité de Démarré, Jacques explique la procédure qui l’a conduite à être mère. « J’avais 17 ans, un 17 juin, quand des hommes se sont débarqués chez mes parents avec la somme de quinze mille (15 000) gourdes (soit 138 euros) pour faire la demande de leur fille», raconte-t-elle.
Cette date fatidique (17 juin) marque le jour où son sort a été scellé et son « Alantran » négocié entre les parents de son actuel mari et les siens. « Je fais le décompte de la somme et je l’ai remise à ma mère avant de sombrer, quelques mois plus tard, dans les bras du jeune homme avec lequel je cohabite aujourd’hui », explique-t-elle.

À l’instar de Resimène Jacques, qui est l’une des rares jeunes filles de la section communale à atteindre la 6e année fondamentale, Alcius Eliamène Joisius, 19 ans, est mère d’un enfant. En octobre 2017, lorsqu’elle avait 17 ans, son actuel mari, Arnold Filius avait versé dix mille gourdes (soit 92 euros) à Macilia Pierre, sa mère, afin qu’Alcius Eliamène Joisius soit devenue sa femme. Trop contente, la mère de la jeune fille qui elle-même a été baptisée dans le rituel d’Alantran, a livré la fillette à l’homme qui l’a engrossé la même année avant de se rendre en République Dominicaine pour se faire une place dans les « Batey* » à titre de « bracero* ».
Mélius Michelose, une autre victime de cette pratique, ne peut pas préciser avec exactitude son âge. Faute de document d’identité. Elle croit avoir 17 ou 18 ans, alors que certains de ses proches pensent qu’elle a une année en moins. Dans un taudis exigu, la jeune femme élève son garçon de 15 mois, né dans les mêmes circonstances. Pour son union avec son actuel conjoint, l’homme avait versé 20 mille gourdes (soit 185,25 euros) à ses parents, raconte-t-elle. « Ils ont apporté l’argent en mon nom tout comme cela a été le cas pour ma grande sœur âgée aujourd’hui de 21 ans », explique Mélius Michelose qui est née dans une famille où la pratique Alantran se propage.
Celiphète Célimène, âgée aujourd’hui de 33 ans, mère de 4 enfants, se souvient elle aussi de son « achat » par son actuel conjoint en 2003. Elle avait 17 ans à l’époque et était en troisième année fondamentale. Son mari, inconnu de l’époque, avait offert 15 000 gourdes (138 euros) à sa mère. Mineure, elle ne faisait qu’obéir aux ordres de ses parents, selon ce qu’elle raconte. « Je ne le connaissais pas, je ne l’aimais pas non plus », avoue-t-elle à propos de son actuel mari. « Après le versement, nous avons commencé à nous rencontrer, et aujourd’hui il est le père de mes 4 enfants », explique-t-elle avec un air de désolation.
Si les quinze ou vingt mille gourdes sont perçues comme une forme de dommage-intérêt par les familles des jeunes femmes, la somme est perçue comme le ‘’prix d’achat’’ de ces dernières par les hommes.
Des filles se rebellent contre cette pratique
Elles portent les mêmes prénoms, mais viennent de famille différente. Leurs histoires d’Alantran, teintées de rébellion, sont connues de toute la localité de « Démarré ». Pierre Jislène ignore son âge, mais fixe le nombre de ses années à 30. En 2017, elle avait désigné par hasard la date du 14 septembre 1989 pour celle de sa naissance afin de faire l’acquisition de son acte de naissance. Sa mésaventure avec la pratique « Alantran » la laisse, désormais, une étiquette de « sorcière » dans son entourage.
Vers la fin de 2006, alors qu’elle supposait avoir 17 ans, les parents de Jislène l’ont envoyé chez un monsieur avec lequel elle devrait partager un toit marital. Belliqueuse, elle raconte avoir tout de suite refusé cette union forcée pour laquelle la personne en question avait payé 3 500 gourdes (32 euros). Elle confrontait au dilemme de quitter la maison ou de cohabiter avec le Monsieur. Le 15 janvier 2007, Jislène Pierre dit avoir laissé sa maison de force pour se rendre à celle de son compagnon pour l’exécution de tâches ménagères.
Dans la foulée, elle raconte qu’elle refusait toute forme d’intimité avec cet homme. Un refus qui lui a coûté de sérieuses réprimandes auprès de ses parents. « Je ne voulais pas de lui », dit-elle avec dédain. « Du coup, je n’ai jamais couché avec lui en dépit des menaces et des agressions sexuelles à répétition dont j’en ai été témoin ».
En 2008, ledit monsieur, maladif, décède suite à une articulation inflammatoire. Soupçonnée par les membres de la famille de son concubin d’être l’auteur de ce décès, Jislène Pierre dit avoir été étiquetée de sorcière par ces derniers. Selon eux, l’homme a été décédé à la date exacte qui coïncide avec la première année de Jislène sous l’habitat de son « acheteur ».
Jislène Moncius quant à elle, est plutôt connue pour son refus catégorique d’un certain « Odma », qui excède son âge. Âgée seulement de 17 ans, Odma avait offert 30 000 gourdes (277 euros) à sa mère en avril 2019. Elle voulait que la petite, encore en quatrième année fondamentale, soit devenue sa concubine. Effrayée par la nouvelle, Jislène Moncius qui dit avoir désobéi à ses parents, déclare avoir pris la poudre d’escampette le jour de son transfert chez son potentiel « concubin-acheteur ». « J’ai fugué chez ma tante le jour même de la cérémonie (Alantran) », raconte-t-elle.
Si pour certaines fillettes Alantran est la meilleure façon d’honorer une jeune fille de la localité, pour Jislène, qui est en quatrième année à l’école Baptise Conservatrice de « Démarré », rien ne la motive que son éducation. « Je préfère continuer avec mes études », argue-t-elle avec fermeté. Son rêve le plus cher c’est de terminer ses études classiques pour, ensuite, entamer des études supérieures.
Indigné face à cette pratique dégradante, le propriétaire de son établissement scolaire, Pierre Wistin, un résident de la zone, appelle à la solidarité citoyenne afin de combattre et bannir cette pratique.
Des autorités locales s’indignent, d’autres s’engagent
« Cette pratique existe depuis fort longtemps dans la localité », témoigne ce dernier qui avoisine aujourd’hui la soixantaine. L’homme se rappelle, dans son enfance, que le montant des échanges variait entre 1,500 gourdes à 2,000 gourdes (13 jusqu’à 18 euros), mais impliquait uniquement des adultes autour d’une tradition assimilée à un régime dotal. « La présence des mineures rend la pratique obscène », pince-t-il.
Un auxiliaire du Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC), appelé couramment « Aide-CASEC », se dit conscient des dérives que peut provoquer la perpétuation de cette pratique. Avec son rôle de police communale de la localité, Ebert Alexandre souligne que la pratique porte des préjudices à double sens. Les enfants sont non seulement victimes d’une exploitation abusive de leurs droits, le pire, elles sont privées de toute liberté de se jeter dans une aventure sentimentale comme bon leur semble. « Un jeune garçon qui n’a pas les 10, 15 ou 20 mille gourdes pour offrir aux parents des jeunes filles, ne fréquentera jamais la fille qu’il désire, même s’ils s’aiment réciproquement », se désole-t-il.
Dans une approche plus soutenue, Joël Saintiphard, originaire de « Démarré », fruit de « Alantran », souligne aussi les possibles violations de droits que peut engendrer la pratique. D’après ce jeune enseignant, « Alantran » entrave sérieusement la vie des mineures, mais aussi handicape toute possibilité de développement dans la zone. Par souci d’engagement, le jeune enseignant qui dit être l’un des membres fondateurs de l’organisation MPDDL (Mouvement des Paysans de Démarré pour le Développement Local), promet d’œuvrer dans le domaine de l’éducation qui constitue un manque à gagner dans la zone.
« Les filles n’ont pas accès à l’éducation, elles nagent dans la pratique avec la plus grande espérance d’avoir un jour leur propre famille. En attendant le support des autorités locales, nous entamons d’ici peu une campagne de sensibilisation afin de les venir en aide », promet-t-il.
Ramel Altidor, membre influent de ladite organisation, pense qu’il faudra une réelle volonté politique afin d’harmoniser le plan des organisations locales avec ceux des organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions nationales. Éducateur et animateur social, il opte pour un changement de mentalité dans la zone. « Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, a-t-il déclaré. Les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la protection de l’enfance doivent définir un plan pour s’attaquer à ce problème qui, à mon avis est aussi un problème politique ».
Leader de la zone, M. Altidor attend la mise en place d’un plan d’action ainsi que des interventions des ONG comme le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) afin de matérialiser les engagements de MPDDL. Cet organisme, rappelle-t-il, compte donner sa contribution dans le domaine de l’éducation, l’accompagnement social, la sensibilisation ainsi que la prévention de la traite des personnes.
Dans une note publiée le 11 juillet 2019, Unicef avait déjà « condamné fermement les cas d’exploitation sexuelle sur mineurs rapportés en Artibonite ».
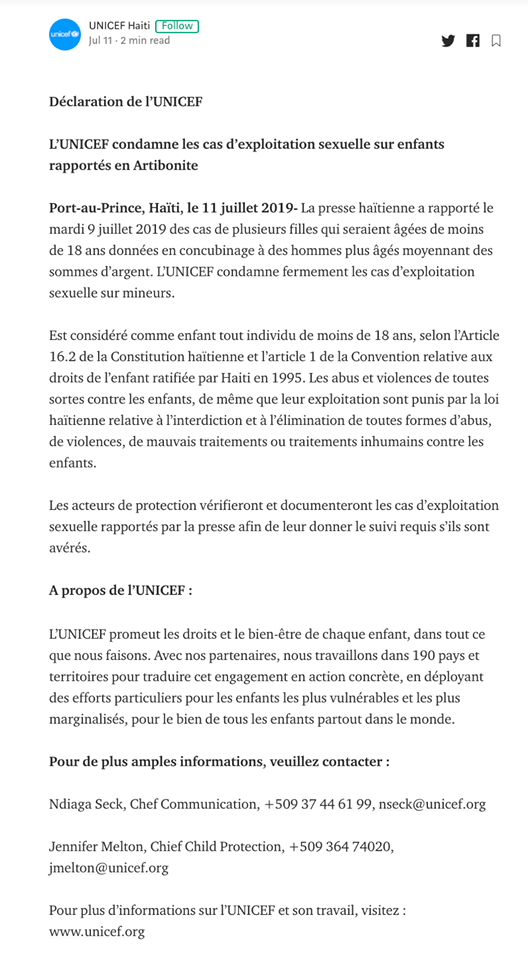
La République face à un défi majeur
Informé de la situation, le protecteur du citoyen et de la citoyenne en Haïti, Renan Hédouville, souligne que « ces pratiques sont dégradantes et enlèvent toute notion de dignité humaine aux victimes ». Le numéro 1 de l’Office de la protection du citoyen et de la citoyenne (OPC), dit regretter qu’après 215 ans d’indépendance, Haïti butte à de telles pratiques qui rappellent les souvenirs funestes de la traite négrière et du Code noir de 1685.
De son côté, le président du Comité Nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), André Ibréus, condamne avec véhémence cette violation flagrante des droits humains. Selon lui, « Alantran » est assimilée à la traite des personnes, et doit être réprimée. « Cette pratique fait resurgir une nouvelle forme d’échange d’être humain qui ressuscite, dans sa matérialisation, les pratiques coloniales du XVIIIe siècle ».
D’autant que la pratique dégage, à des degrés moindres, des similarités à la « traite des personnes » lorsqu’on se réfère à la loi du 2 juin 2014 (art. 1.1.1 ». La traite est ainsi définie : « le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, par la fraude, la tromperie, par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation ».
L’avocat de profession rappelle, par ailleurs, qu’Haïti a signé et ratifié une panoplie d’instruments internationaux dans le cadre du système onusien de protection des droits de l’homme interdisant la traite des personnes. Parmi eux, il cite : la Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants ; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, esclavage, travail-forcé, trafic de personnes du 2 décembre 1949 ; la Convention relative au droit de l’enfant du 20 novembre 1989 ainsi que le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000.
Malgré cette batterie de textes juridiques qui exprime l’existence d’une prise de conscience théorique de la valeur inhérente des droits humains et le danger que représente la traite des personnes face à de tels droits, Haïti croupit sous le poids de la domesticité infantile (communément appelée Restavèk ou Reste avec). Mais aussi la traite transfrontalière, la traite des enfants en milieu institutionnel, puis, « Alantran », qui font d’Haïti un élève à surveiller dans la lutte contre la traite des personnes. D’ailleurs, le rapport du département d’État américain de 2019 sur la traite des personnes (TIP) fait état de 286 000 enfants vivant actuellement en situation de Restavèk, mentionne par ailleurs qu’Haïti demeure jusqu’ici un pays d’origine, de transit et de destination du trafic des êtres humains au niveau national et transnational.
En route vers d’éventuelles solutions
L’organisation non-gouvernementale « Lumos Foundation », qui vient de décrocher le 31 juillet dernier, un partenariat avec l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), pour une durée de quatre ans (2019-2023), dit inclus déjà la pratique « Alantran » dans son plan d’action. Avec une enveloppe de 5,6 millions de dollars américains, l’ONG espère renforcer la capacité du gouvernement haïtien, des autorités locales et de la société civile à prévenir, reconnaître, et combattre la traite des personnes. D’ailleurs, des institutions étatiques notamment le CNLTP avaient fait la présentation le 31 juillet 2019, d’un document de politique publique, intitulé « Stratégie et plan national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022 ». Son objectif principal c’est d’« inverser la tendance ».
Pour corroborer ce plan, le directeur de la fondation Lumos en Haïti, Eugène Junior Guillaume, propose déjà des stratégies à court terme ainsi que des mesures de solutions définitives à adopter. Un programme baptisé « Bâtir un Environnement Solide pour Éradiquer la Traite des Personnes – BEST », a été élaboré pour faciliter la mise en place d’un service de protection pouvant apporter toutes les assistances nécessaires aux victimes, particulièrement celles liées à leur réhabilitation.
Avec une stratégie 4P (Prévention, Protection, Poursuite et Prise en charge), le numéro 1 de la fondation britannique en Haïti compte apporter des réponses concrètes à ce fléau. « En faisant la prévention, nous essayerons de comprendre avec nos partenaires quelles sont les pratiques, les connaissances et les attitudes qui sont susceptibles de faciliter la traite », explique-t-il.
Pour la protection, il entend impliquer les acteurs communautaires afin de les former par le biais de messages directs. Parmi ces leaders, il cite expressément les leaders religieux qui ont un ancrage dans les milieux ruraux. La poursuite quant à elle se fera avec les organes étatiques ainsi que les différents ministères concernés par la répartition de la justice. Au niveau de la prise en charge, monsieur Guillaume entend accompagner les victimes à travers les travaux de la fondation. « Alantran est une pratique qui porte atteinte à la dignité des victimes », déclare-t-il.
Les institutions étatiques évoluant dans le domaine de la protection de l’enfance font des efforts incontestables. La contribution annuelle des bailleurs américains et canadiens au profit d’un tiers des orphelinats en Haïti s’élève à environ 100 millions de dollars américains. En dépit de toutes ces actions, Haïti cache encore des pratiques qui soulèvent de profondes interrogations sur les efforts entreprendre dans la construction d’une société basée sur le respect des droits de la personne humaine.
Il y a de cela 215 ans, Haïti a combattu pour le respect des droits et de la dignité humaine. Il ne fait aucun doute que la traite des êtres humains, sous toutes ses formes, constitue une préoccupation majeure pour ce pays restaurateur de bien-être.
Marc Evens LEBRUN (journaliste)
Luckenson JEAN (vidéographe)
Websder CORNEILLE (journaliste)
Référence et documents consultés
Le rapport de 2019 du département d’État Américain sur la traite des personnes dans le monde / (TIP) 2019.
Batey* : Un batey est un campement où vivent les coupeurs de cannes en République dominicaine
Bracero* : nom farouche donné aux travailleurs exerçant la coupe de canne en République Dominicaine
Le taux de change de l’Euro a été calculé en fonction du taux des banques commerciales d’Haïti rapporté par le site https://fr.exchangerates.org.uk/taux-de-change/HTG.html, en date du 12 décembre avec 1 EUR = 107.96
Musique de fond: Tristan Lohengrin / Time of solitude
*Ce texte a été publié pour la première fois dans la presse par le journaliste Marc-Evens Lebrun le 15 Décembre 2019 sur le site du média en ligne Loop-Haïti.

